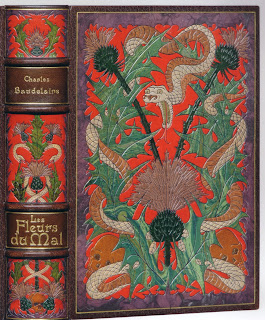LA DERNIÈRE ÈPOPÈE DE
MAURICE BARRÈS
« Les
jardins de Qalaat étaient réputés parmi les plus beaux de la Syrie, dans un
temps où les Arabes excellaient dans l’art d’exprimer avec de l’eau et des
fleurs leurs rêveries indéfinies d’amour et de religion », note Maurice
Barrès, dès les premières lignes de son roman Un Jardin sur l’Oronte. Celui-là évoque la Syrie au XIIIe siècle,
mettant en scène un jeune Franc chrétien, Guillaume et Oriante, musulmane,
favorite de l’ Émir qui vient de conclure un traité de paix avec le comte de
Tripoli. Le chevalier tombe amoureux de la jeune femme qui lui envoie
« une meilleure qu’elle », sa suivante Isabelle la Savante. Guillaume
vit une fausse félicité, jusqu’à ce que le comte d’Antioche qui n’avait pas
négocié de trêve, ne vienne mettre le siège devant Qalaat. Au cours des
affrontements, l’Émir trouve la mort, laissant ainsi les deux jeunes gens,
libres de vivre leur amour. Le récit ne s’achève pas de la sorte ;
Guillaume et Oriante se perdent avant de se retrouver et être séparés à jamais.
Un Jardin sur l’Oronte est une épopée
à trois voix où l’on choisit l’enfer comme un délice, ou l’inverse. Des bras
d’Isabelle à ceux d’Oriante, Guillaume, en goûte tous les délices et toutes les
amertumes.
Un Jardin sur l’Oronte a été publiée par
Plon-Nourrit, le 17 mai 1922, (in-12). Le tirage de tête a été tiré à 50 exemplaire
sur papier de Chine. Avec cet ouvrage,
« Barrès, “vieux croisé sexagénaire” débouclait enfin son armure dont « il
laisse tomber les pièces sur le gazon oriental des jardins de l’enchanteresque
Oriante», notait André Fraigneau dans la préface qu’il donna à une réimpression
dans la collection Alphée des Éditions du Rocher (1988). Ce roman, le dernier
que Barrès ait écrit, car il mourut l’année suivante de la parution, ne plut
pas à tout le monde. Il fut vilipendé par les néo-thomistes qui avaient vu,
auparavant, en lui, l’un des chantres de la religion. Vallery-Radot publia dans
La Croix, un article vengeur : « Ce
qui nous cause un certain malaise dans la lecture de ce Jardin sur l’Oronte,
c’est que hiérarchie classique des valeurs morales et religieuses se trouve bouleversée ».
Barrès a confié à André Fraigneau qu’il était furieux de ces réactions. Mais
quelle apothéose dans la “trahison” !
En fait, Oriante ressemble à Anna
de Noailles, née Brancovan, l’amour de sa vie. Les traits de “la musulmane
courageuse” sont transparents. On ignore qu’ils s’étaient retrouvés et se
revoyaient en secret depuis 1916. Comme tout bon écrivain - sincère - ils
avaient conservé chacun le double de leurs lettres. Ils se mirent d’accord -
preuve qu’ils se rencontraient - pour
que leur correspondance soit publiée en l’an 2000. Ce souhait n’a pas été
respecté, elle a été publiée en 1994 (1). Entre temps, Un Jardin sur l’Oronte a bénéficié de trois éditions illustrées. La
première chez Alexis Rieder à la librairie de la Revue Française par Hermine
David par Hermine David (3/6 pointes sèches) ; la deuxième en 1926, aux Éditions G. Crès, par Othon Friesz avec
47 bois ; et la troisième aux éditions
Javal & Bourdeaux, par André Suréda. Celui-ci réalisa 17 aquarelles, gravées
sur bois par Robert Dill. Il en a été tiré 490 exemplaires, dont 75 sur Japon
impérial. On en rencontre contenant une suite des illustrations sur Japon
impérial, la décomposition d'un hors-texte sur Chine et une suite des têtes de
chapitre et des culs-de-lampe en noir et or sur Chine.
A Qalaat,
en Syrie, un jardin conserve la fraîcheur de ses fleurs et des ses plantes. Des
ruisseaux tirés de l’Oronte – dont le nom signifie en arabe, “rebelle” - le
baigne sans cesse et murmure autour des buissons. On croit entendre parfois
chanter une voix féminine : « Le bleu est sur Damas, sur Tripoli,
sur l’Europe, sur le désert, sur toute
l’Asie, mais non ici. Dans tes bras, où que ce soit, je trouverai le bonheur,
je trouverai l’univers. Mais toi, tu préfères nos souffrances et ta chaîne, à
la liberté d’être tout l’un pour l’autre ».
(1) Anna de Noailles, Maurice Barrès : correspondance
1901-1923. Par Claude
Mignot-Ogliastri, L’Inventaire, 1994.